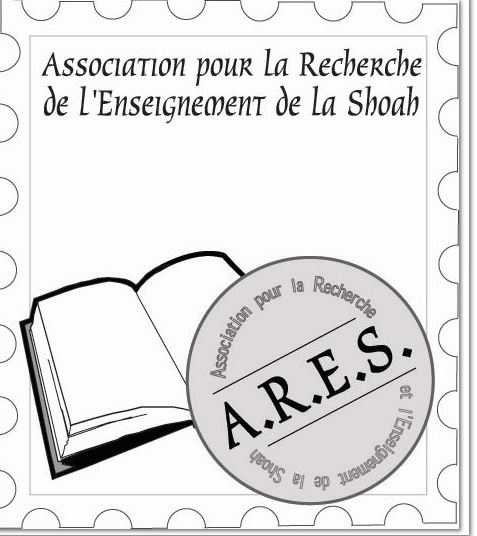GARDIENNES DES CAMPS DE CONCENTRATION.
par
AUFSEHERIN, GARDIENNE DES CAMPS DE CONCENTRATION.
Aufseherin est le terme allemand pour désigner une gardienne auxiliaire des SS dans les camps de concentration nazis. (l’article qui suit a été publié dans Dictionnaire de la Méchanceté, Edition Max Milo Beaux livres, 2013)
Dans l’univers concentrationnaire, les femmes gardiennes sont tard venues, même si certaines suivent un entraînement dès 1938 dans le château Lichtenburg en Saxe (notons pour rappel que les premiers camps ouvrent en 1933). Dans la plupart des camps, parce qu’ils ont été en quelque sorte obligés, les nazis ont fait appel à des Aufseherinnen. Elles sont considérées comme gardienne auxiliaire des SS. Elles surveillent les femmes à l’intérieur du camp et à l’extérieur quand elles accompagnent les commandos de travail. « A coups de pied, à coup de poing, a coups de cravache ..[ elles] jettent les femmes qui doivent ensuite former des colonnes » et avancer en chantant le Halli, Hallo d’après Les françaises à Ravensbrück.
Elles ne sont pas toutes volontaires ou affiliées au parti nazi, certaines sont requises par la loi. Mais elles font toutes, preuve, à quelques exceptions prés, d’une très grande cruauté, par plaisir, par devoir, ou conformisme.
Il est difficile de préciser quelles furent leurs motivations, bien qu’un film récent (The Reader) adapté du best-seller d’un auteur allemand (Bernhard Schlink), Le Liseur, ait jeté un coup de projecteur bienveillant sur l’une d’entre elles. Il est sûr que la propagande faite dans des annonces de la presse pour les attirer insistait sur l’amour du pays et le patriotisme. Elles sont également comme l’héroïne du film, à la recherche d’un emploi et nombre d’entre elles sont issues des classes moyennes inférieures. Rappelons pour mémoire qu’une gardienne de camp gagne en moyenne le double du salaire d’une ouvrière, soit 185 RM net, et de plus elle est logée et nourrie, ce pour quoi elle doit s’acquitter d’une certaine somme (environ une quarantaine de RM pour la nourriture, 15 pour le logement) . Sur un échantillon de 200 d’entre elles, analysé par Germaine Tillion, on trouve toutes les catégories de métiers : contrôleuses de Tramway, ouvrières d’usines, chanteuses d’opéras, nurses diplômées, coiffeuses, paysannes, institutrices à la retraite, écuyères de cirque etc.…Des gens ordinaires !
Ainsi Hermine Braunsteiner née le 16 juillet 1919 à Vienne en Autriche, morte le 19 avril 1999, cadette d’une famille d’ouvriers catholiques pratiquants est obligée de travailler très tôt d’abord dans une brasserie puis femme de chambre et domestique en Angleterre entre 1937 et 1938. Quand la guerre éclate elle revient à Vienne et sur l’insistance de son logeur, elle postule à un poste susceptible de lui garantir de bonnes conditions de travail et un bien meilleur salaire : gardienne de prisonniers. Le 15 août 1939, elle commence une formation de gardienne SS au camp de concentration de Ravensbrück sous l’égide de Maria Mandel. En octobre 1942 elle se retrouve à l’usine de textile dans le camp de concentration et d’extermination de Maidanek près de Lublin en Pologne. Puis elle est promue assistante gardienne. C’est dans ce contexte qu’Hermine Braunsteiner se livre à de nombreuses exactions. Selon des témoignages elle bat les prisonnières à mort et aurait pris personnellement part aux sélections qui conduisent des femmes et des enfants aux chambres à gaz. Est-ce pour ses coups de pieds ou coups de bottes particulièrement dangereux ou est-ce pour son obéissance que les déportées la surnomment « La Jument » ou la Jument servile ? Lila Givner témoigne au tribunal de Düsseldorf : « La Kobyla (H Braunsteiner) était grande, elle rentrait littéralement dans les gens, …Elle m’est rentrée dedans, j’en ai des cicatrices…Quand quelqu’un se trouvait sur son chemin, elle levait la jambe et frappait. C’était comme ça avec moi aussi ; je suis tombée sur elle dans le camp et je ne me suis pas poussée à temps. Elle m’a donné un tel coup de pied que je suis tombée. Quand j’étais à terre, elle a continué. Puis quand je me suis relevée, elle m’a frappée dans le dos et je suis tombée sur le ventre. Elle a continué à me piétiner… »
Ces femmes sont jeunes, célibataires. Elles suivent une formation d’abord en Saxe puis au camp de Ravensbrück. Limitées aux grades subalternes, très peu (deux ou trois) sont parvenues aux grades de chef de camp (Lagerführerin) comme Maria Mandel nommée par Rudolf Höss le commandant d’Auschwitz, particulièrement satisfait de son travail, ou au grade plus élevé d’inspectrice senior (Oberaufseherin).
Jenny-Wanda Barkmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Eva Paradies, Gerda Steinhoff, toutes cinq à peine âgées de 20 ans sont arrivées au camp du Stutthof, non loin de Gdansk (Danzig) entre 1942 et 1944. Engagées dans l’établissement principal et dans ses annexes (Stutthoff III, Dantzig-Holm, Bromberg Ost), toutes se distinguent par leur brutalité envers les prisonnières et certaines d’entre-elles, dont la chef-surveillante Gerda Steinhoff, procèdent régulièrement à des sélections pour la chambre à gaz.
Dorothée Binz, n’a que 19 ans lorsqu’elle arrive en 1939, à Ravensbrück pour être formée. Elle va gravir rapidement les échelons pour se retrouver, dès 1943, chef-surveillante, responsable de la formation des futures gardiennes. Sa cruauté est rapportée par de nombreuses prisonnières, dans les rangs desquels elle défilait, lors de l’appel, fouet dans une main et berger allemand en laisse dans l’autre, faisant usage des deux souvent de façon totalement imprévisible.
Elles obéissent aux hommes et ne peuvent atteindre le grade de commandant de camp. Par exemple, tous les S.S, gardiens de Ravensbrück avaient sous leurs ordres des auxiliaires féminins placées sous les ordres d’une surveillante-chef (Oberaufseherin), elle-même subordonnée au SS- Schutzhaftlagerfuhrer responsable du camp.
Dans les camps, la place des gardiennes comme leur nombre n’égale pas ceux des hommes : elles représentent moins de 10% du personnel concentrationnaire. Mais le rapport change dans les camps féminins en 1942 avec l’augmentation des déportées. Ainsi selon les déclarations du commandant Fritz Suhren à son procès, environ 3 500 Aufseherinnen et 950 hommes servent à Ravensbrück et dans ses Commandos extérieurs entre l’automne 1942 et le printemps 1945.
De son côté le rapport du très officiel Office central de gestion économique de la SS daté du 15 janvier 1945, précise 1 008 hommes et 546 femmes affectés au service de garde SS du camp de Ravensbrück et de ses annexes.
Comment expliquer que ces femmes aient atteint un degré de cruauté inimaginable ?
Bien sûr on peut répondre par le concept de banalité du mal comme le fait Hanna Arendt dans son ouvrage, Eichmann à Jérusalem. Étude sur la banalité du mal (1963), ou comme tout récemment le démontre Margarethe Von Trotta dans son dernier film Hannah Arendt (2013.) Certes on retrouve chez ces femmes, comme chez Eichmann, l’obéissance aux ordres sans questionnement, sans état d’âme, sans conscience du bien et du mal puisque la seule morale est l’obéissance ou l’idée qu’elles se font du devoir.
C’est ce qui transparait dans le témoignage des nombreuses déportées rescapées qui comme Fania Fénelon (Sursis pour l’orchestre), Ruth Fayon (Auschwitz en héritage), ou Denise Holstein (Je ne vous oublierai jamais, mes enfants), ont écrit leurs expériences. S’ajoute pour beaucoup de ces gardiennes un fanatisme outrancier qui explique que, même quand elles sont capables d’un geste de « bonté », elles reviennent à des attitudes de cruauté flagrante. Voici un exemple cité par Fania Fénelon à propos de Maria Mandel, « la bête » d’Auschwitz qui avait pris sous son aile un petit garçon qu’elle avait arraché à une mort certaine. « …Elle l’a fait habiller comme un gosse de riche, une merveille ! Rien n’a dû être trop beau….Pendant plusieurs jours elle promène fièrement l’enfant dans le camp » et finit par le porter elle-même à la chambre à gaz. C’est encore Maria Mandel qui sans doute a protégé longtemps Alma Rosé et son orchestre féminin d’Auschwitz pour finir sans doute par l’empoisonner.
Irma Grese peut être citée comme l’exemple parfait du fanatisme. Dès la fin de sa scolarité, elle s’engage dans la Bund Deutscher Mädel (Ligue des jeunes filles allemandes), section féminine apparentée aux Jeunesses hitlériennes. Désirant devenir infirmière, mais n’ayant pas les capacités requises et après avoir travaillé un temps dans un hôpital SS, elle est transférée à Ravensbrück pour y être formée en qualité de surveillante des camps. Plusieurs témoignages de rescapés la décrivent comme brutale et sadique, toujours équipée d’un fouet et d’un pistolet dont elle se servait selon ses imprévisibles pulsions. Elle termine sa carrière au camp de Bergen-Belsen. Le 17 avril 1945, elle est arrêtée lors de la libération du camp par les troupes britanniques. Au procès de Lüneberg, elle est reconnue coupable de crimes de guerre et exécutée, à l’âge de 22 ans, par pendaison le 13 décembre 1945…
L’arrivisme, l’ambition peut être un ressort. C’est le cas de Irma Griese qui « par promotion, intrigues, démonstration de sa capacité à se faire obéir sans défaillance, deviendra Lagerälteste » (Jean-Jacques Felstein in Le Secret de ma mère).
C’est aussi le cas des époux Koch à Buchenwald. Après un parcours dans les rangs du NSDAP, lui est nommé chef de ce camp, il a la réputation d’un être corrompu et sadique. Elle, est gardienne. Ilse Koch a 31 ans quand en 1937, elle vient au camp de Sachsenhausen, en cours de formation pour devenir aufseherin. A Buchenwald c’est la femme du chef, elle abuse sans limites de sa position, insultant et battant les prisonniers avec une rare cruauté. Gardienne dégénérée, elle aurait poussé sa déviance jusqu’à demander qu’on lui fabrique divers objets (gants, couvertures de livres, abat-jours, etc…) à l’aide de peau humaine tatouée prélevée sur les cadavres, parfois victimes de sa propre barbarie. Les détenues l’appelaient "la sorcière ou la chienne de Buchenwald ».
Peut-on en pastichant la formule de Simone de Beauvoir, tenter une hypothèse et affirmer qu’on ne naît pas méchant, on le devient. A l’appui de cette assertion, on laisserait supposer une responsabilité du système, et donc une responsabilité collective (ce qui n’a rien à voir avec la position d’Hannah Arendt qui au contraire aboutit à une responsabilité individuelle). Peut-on expliquer ? Certes nous avons en tête l’image d’une organisation systématique de la terreur. Cependant rien dans le règlement des camps ne donnait officiellement aux surveillants le droit de violence ou de mort (Bernard Strebel 2005). Mais alors pourquoi la pratique est-elle si différente ?
Tout d’abord est en cause l’organisation du camp, seul environnement socio-culturel de ces femmes, (voir les descriptions très connues d’Eugène Kogon, d’Hermann Langbein ou encore de David Rousset). Il y règne une vie et un emploi du temps très minutieusement organisé. Une hiérarchisation extrême des fonctions, pousse toujours les gardiens à faire mieux pour avancer ou tout simplement pour ne pas être dépassé. Le camp est un microcosme fermé sur lui-même, avec à l’intérieur, une répartition des grades et des fonctions. D’un côté, nous trouvons des Allemands (chefs de camps, SS, Aufseherin,) et de l’autre, les déportés qui sont intégrés, pour certains, dans cette hiérarchie mortelle (Kapos, gardiens de blocks, assistantes des gardiennes ou stubovas). Chaque baraque dans le camp était placée sous l’autorité d’une gardienne Aufseherin.
Vient ensuite la formation qui bien que courte est semble-t-il efficace.
L’ethnologue Germaine Tillion, elle-même arrêtée et déportée en 1942, (Ravensbrück, 1946, puis 1973 et enfin 1988), constate tout comme Margaret Buber-Neumann, son amie, (Déportée à Ravensbrück, 1988) que les débutantes, timides, empruntées voire même effarées, ne sont pas cruelles, loin de là, mais elles le deviennent très rapidement. « Pour une petite aufseherin de vingt ans qui le jour de son arrivée .disait « pardon » lorsqu’elle passait devant une prisonnière,.il a fallu exactement quatre jours avant qu’elle ne prît [le ton]… ». Un autre témoignage, celui de Sylvie Paul, rapporté par le service d’information des crimes de guerre en 1946, permet de constater l’efficacité de la formation. Sylvie Paul raconte : « A un moment donné, les autorités allemandes manquaient de femmes SS. On les recrutait alors d’office dans les usines sans même qu’elles aient le temps de prévenir leurs familles. … » Après une période de formation par contingents de 50 « elles étaient mises à l’essai ». On leur demandait de frapper un interné. « Je me souviens que sur plusieurs contingents…3 seulement ont demandé pourquoi et une seule s’est refusée à le faire ». Cette dernière sera mise en prison.
La recherche du pouvoir est en soi une autre explication. Violence et pouvoir sont alors indissociables (Elissa Maïlander 2012).
Le pouvoir de l’uniforme (doit-on rappeler à ce niveau l’expérience menée par le psychologue américain Stanley Milgram, illustrée par le film français I…comme Icare (1979) dans lequel l’uniforme incite à la soumission à l’autorité) joue son rôle. L’uniforme pour les nazis est un signe d’appartenance à une élite politique établie selon des critères raciaux. Encadrées, habillées, logées, les gardiennes de camps appartiennent corps et âme au nazisme dont elles sont les représentantes et les garantes.
L’historien ne peut que décrire. Le psychanalyste ou le sociologue peuvent entrer alors en scène pour tenter d’expliquer. Citons une dernière fois Germaine Tillion (1988, p134) : « Une chose m’a frappée ; c’est le rapport qui existait, chez gardiens et gardiennes, entre débauche et la cruauté, spécialement chez les femmes… Peut-être que les SS, hommes et femmes ne pouvaient pas déployer tant de cruauté sans en ressentir de l’angoisse- et que les débauches sont une des expressions ou un de ses palliatifs ».
Renée Dray-Bensousan
Aix-Marseille Université
UMR -TELEMME-MMSH
Bibliographie/Sources :
Fabrice D’Almeida , Ressources inhumaines : les gardiens de camps de concentration et leurs loisirs : 1933-1945, Fayard, 2011 ; Philippe Aziz, « Les femmes SS », Historia, no 425, avril 1982, p. 48-58 ; Hermann Langbein, La résistance dans les camps de concentration nationaux-socialistes, 1838-1945, Fayard, 1981 et Hommes et femmes à Auschwitz, réédité en collection de poche, Texto, 2011 ; Amicale de Ravensbrück, Les Françaises à Ravensbrück, Denoël, 1965 ; Elissa Maïlander, « La violence des surveillantes des camps de concentration national-socialiste (1939-1945) : réflexions sur les dynamiques et logiques du pouvoir », Encyclopédia of Mass Violence ; Bernhard Strebel, Ravensbrück. Un complexe concentrationnaire, Paris, Fayard, 2005 ; Germaine Tillion, Ravensbrück, Point Seuil, 1988.