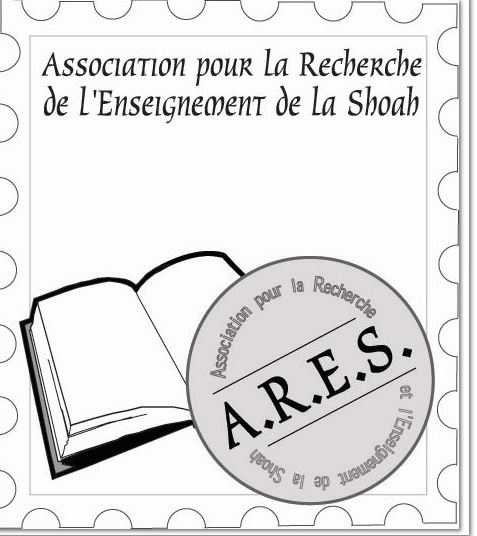« Irène Némirovsky »
Auteur : Jonathan Weiss
Titre : « Irène Némirovsky »
Paris, Le Félin/Kiron, collection « Les marches du temps », 2005, 219 pages, 18.90 euros
Le 8 novembre 2004, le prix Renaudot lui était décerné à titre posthume, pour son roman « Suite Française », description grinçante et si réelle de certains Français pendant la débâcle et l’exode. Une France en perdition. Irène Némirovsky sortait des oubliettes de l’histoire littéraire et des oubliettes de l’histoire tout court, elle qui avait été, comme plus de 75000 autres juifs, déportée de France. Arrêtée le 13 juillet 1942, détenue à Pithiviers, elle fut envoyée à Auschwitz-Birkenau le 16 par le convoi numéro 6. Elle y mourut un mois plus tard d’une épidémie de typhus. On avait oublié pendant des décennies qu’elle avait été une brillante femme de lettres. On redécouvre aujourd’hui tous ses ouvrages. Irène Némirovsky est en effet l’auteur de nombreuses nouvelles (au moins 33 entre 1931 et 1942) et de treize romans, dont le célèbre David Golder sans oublier une biographie de Tchékhov. A la fin des années trente, elle vivait de sa plume.
Elle était née en 1903 à Kiev, dans une Ukraine qui faisait alors partie de l’empire russe, dans une riche famille de banquiers juifs. En 1917, sa famille avait quitté
Jonathan Weiss n’a pas opté pour une « biographie du détail » : il ne suit pas l’auteur pas à pas en décrivant minutieusement tous les événements de sa vie. Il évoque tous les moments marquants mais, ce qui fait l’intérêt de ce livre, en choisissant de confronter en permanence Irène Némirovsky à son œuvre, mettant l’accent sur la relation complexe entre l’écrivain et son identité culturelle. Etait-elle un écrivain juif ? Quels étaient ses liens avec le pays d’origine (plusieurs de ses héros de romans sont russes) ? Quels étaient ses rapports avec le judaïsme ? Elle ne venait pas d’une famille pratiquante. Elle était allée se déclarer comme juive en 1940 mais s’était convertie au christianisme avec son mari. Certains de ses livres, David Golder le premier, reprenaient de nombreux clichés de l’antisémitisme qui courait alors en Europe : le rapport à l’argent, la cupidité. Elle avait publié dans Gringoire, journal antisémite, fréquenté des auteurs antisémites. Certains la portaient aux nues, alors qu’elle était juive ! Aujourd’hui, des auteurs, des chercheurs se sont interrogés sur cet antijudaïsme, se demandant si c’était pour être mieux intégrée dans la société française. Pour l’auteur, qui analyse ses ouvrages (David Golder, Le Bal, Les chiens et les loups) cela s’explique dans son contenu romanesque, par sa vision personnelle d’un ordre moral : l’argent, l’adultère sont des thèmes qu’elle exploite, en montrant que l’argent pervertit, que l’on soit juif ou pas et que cela conduit à la solitude, à partir du moment où la nature humaine, qui est d’aimer sans réserve, se focalise sur l’amour de l’argent. Elle brosse donc aussi des portraits de juifs (David Golder, Ada Sinner) qui veulent aller à rebours de cette image négative avec un retour aux sources. Elle les réinvente.
Pour ce qui est de son identité culturelle, n’est-ce pas elle qui, lorsqu’on l’interroge en 1940 donne la meilleure réponse : « Je désire, j’espère, je crois être un écrivain plus français que russe. J’ai parlé le français avant de parler le russe. J’ai passé la moitié de mon enfance dans ce pays et toute ma jeunesse et ma vie de femme ici. Je n’ai jamais écrit en russe que mes rédactions scolaires. Je pense et je rêve en français. Tout cela est tellement amalgamé à ce qui demeure ne moi de ma race et de mon pays qu’avec la meilleure volonté du monde, il m’est impossible de distinguer ou finit l’un, où commence l’autre. » Mais elle ne fut jamais une Française « de papiers » et le traitement dont elle fit l’objet sous l’occupation lui montra que contrairement à ce qu’elle pensait, il y avait un fossé entre son identité culturelle et son identité nationale. Découvrir ou redécouvrir son œuvre est le meilleur hommage qu’on puisse aujourd’hui lui rendre.
Compte-rendu de lecture de Christine Guimonnet