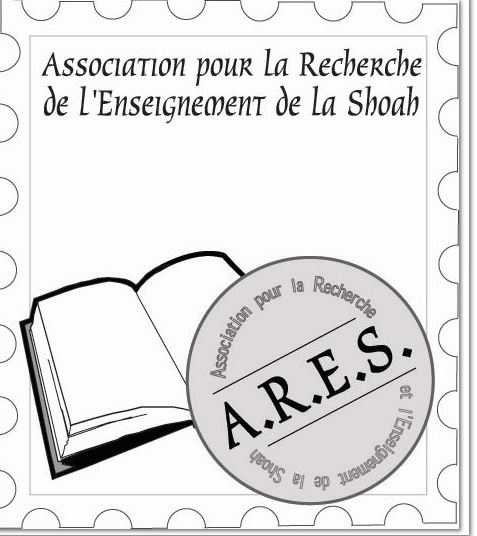Hannah Arendt et la construction de l’universel par Olivier Solinas
Hannah Arendt et la construction de l’universel par Olivier Solinas
(Extrait des Cahiers d’ARES n° 5 ; Les Femmes dans la Shoah)
Je voulais simplement examiner, ici, avec vous, dans ce séminaire sur la place des femmes dans la Shoah, la façon dont l’une d’entre elles, une philosophe, Hannah Arendt, a pensé l’universel.
Je voudrais mettre à jour les présupposés de ma démarche : Il ne s’agit pas tant de montrer comment une femme peut avoir une vision particulière de l’universel ; que de montrer comment une philosophe pense l’universalité du genre humain : Non pas la femme (ce qui me paraissait discriminant, restrictif) ; mais la philosophe (l’occasion de réfléchir la pertinence d’une pensée.)
Et, puisque nous en sommes, toujours et encore, aux remarques liminaires ; je voudrais dire, ici, combien ce que je vous propose de penser doit en fait beaucoup à un livre de Julia Kristeva : Le génie féminin (Tome 1, Hannah Arendt.)
Comment, alors, se construit l’universalité de l’humain chez la philosophe ? Sur ce que l’on pourrait appeler, en première analyse, des ambiguïtés, des errances de la pensée, pour ne pas dire des erreurs.
Car Hannah Arendt est d’abord une penseuse du politique. Or, peut-être, plus que toutes les autres activités humaines, le politique est le lieu des compromis et de l’universel.
Et, sur ce plan, il nous semble qu’Arendt a eu à composer avec tout ce qui formait sa singularité (Etre juive, être femme, être philosophe, …) pour définir ce qui constitue la trame de toute réflexion de philosophie politique et de Philosophie morale : L’universalité du genre humain.
Comment ne pas penser, ici, à ce que Marcel Conche écrit dans son livre Philosopher à l’infini : « Qu’il est difficile, ensuite de retrouver, sous l’homme de telle ou telle particularité, l’homme universel ! »
Etre juive :
Premier exercice de composition : Comment Hannah Arendt intègre le fait qu’elle soit juive à sa pensée de l’universel ?
Elle doit sa célébrité, on le sait, à son ouvrage d’anthropologie politique intitulé Les Origines du totalitarisme .
L’étude s’efforce de retracer la cristallisation d’un mal absolu : l’idée, et sa mise en pratique au XXe siècle, selon laquelle l’humanité est superflue.
Il s’agit, donc, pour la philosophe de penser l’humanité, précisément contre et à partir de l’idée qu’elle est devenue superflue.
S’appuyant sur l’économie, la politique, la sociologie, voire la psychologie sociale, puisant à la littérature et à la philosophie, Arendt raconte une Histoire faite d’histoires personnelles et collectives : les « données » transitent par l’imaginaire et sont instrumentalisées par l’idéologie la plus mortifère que l’humanité ait jamais connue, puisqu’elle parvient à décréter que certains humains sont superflus.
Il y a donc bien là, il me semble, un premier sacrifice qui correspond à un premier fait politique : Sacrifier les petites histoires pour raconter la grande Histoire, celle qui part du fait des camps de concentration et d’extermination.
Tel est le mal absolu : Certains humains sont devenus superflus, ou bien, faut-il dire, sous la poussée de l’utilitarisme et de l’automatisation, et à la longue, tous les humains ?
Telle est la crainte, nullement déguisée, d’Arendt. Mais, comment va-t-elle s’y prendre ?
Son ambition, de dépister les « origines » ou la « nature » de cette horreur, est tempérée par sa perspicacité intellectuelle. La catégorie de la « causalité » étant étrangère au domaine des sciences historiques et politiques, il s’agit de repérer des « éléments » qui ne deviennent une « origine des événements que lorsqu’ils se cristallisent dans des formes fixées et bien déterminées. Alors, et alors seulement, on peut en retracer l’histoire jusqu’à l’origine. Les événements éclairent leur propre passé, mais jamais ils ne peuvent en être déduits » .
Arendt reconnaît ainsi que la « cristallisation » qu’elle déchiffre au rebours des événements, en recherchant dans le passé des « éléments » annonciateurs, s’apparente à un processus imaginaire emprunté à la littérature.
Stendhal ne parlait-il pas de la naissance de l’amour comme d’une « cristallisation » ?
Etrange façon, on le voit, de penser l’universel. Il s’agit, ici, de tout, sauf d’une méthode historique classique.
Ailleurs, elle révèle que son intention était de donner « la structure élémentaire » (the elemental structure) du totalitarisme .
Il convient de rappeler, ici, que Claude Lévi-Strauss venait alors de publier Les Structures élémentaires de la parenté (1949), et le structuralisme prenait de l’ampleur, analysant les éléments constitutifs de la « pensée sauvage ».
Seul l’aboutissement paroxystique des « éléments » en « événements » conduit à désigner dans les premiers (les éléments) les ingrédients des seconds (les événements.)
Quant au processus de la « cristallisation » elle-même, le chercheur ne peut qu’en raconter l’histoire, fondée sur des faits incontestables autant que sur des interprétations déterminées par ses propres implications, ses choix politiques et ses jugements personnels, qui ne sont pas immédiatement moraux, mais découlent d’un ensemble de paramètres.
La construction de l’universel fait donc, quelque part ici le sacrifice d’une certaine forme d’objectivité. Si la méthode rationnelle est congédiée, la cristallisation reste limitée dans son application.
Arendt a récusé, par ailleurs, on le sait, tout « engagement » à la manière de Sartre, pour ne revendiquer que la place du « spectateur » extérieur à l’action. Seul le spectateur peut juger cette dernière avec impartialité : telle est la condition nécessaire qui permet au jugement de devenir une action, la plus pertinente de toutes.
Il nous faut donc repartir de ce fait, de cette donnée politique : Juger l’Histoire depuis notre place de spectateur.
La philosophe va alors décrire ce qu’elle observe depuis la place qui est la sienne. La lucidité d’Arendt sur son implication, sa passion de la vérité, dévoilée comme étant à la fois une vérité personnelle (celle d’une Juive ayant échappé à la Shoah) et une nécessité historique universelle (celle du jugement le plus informé et le plus rigoureux, parce qu’il ne se contente pas d’être cohérent, mais se fonde sur un impératif moral qui n’est autre que l’amour d’autrui), font de son livre, Les Origines du totalitarisme, un témoignage unique.
Aujourd’hui, avec le recul, sans négliger la pertinence des analyses historiques et la vigueur du pamphlet moraliste - saluées ou critiquées dès la publication -, la qualité essentielle de ce texte réside avant tout dans l’art de raconter le roman du siècle : Les Origines du totalitarisme se présentent en effet comme une série d’histoires individuelles et collectives entremêlées à l’histoire personnelle Le génie de la narratrice, elle-même aux prises avec la « cristallisation ».
L’universel devient affaire de position, de point de vue sur le spectacle de l’histoire.
Raymond Aron, qui rend compte du livre dès janvier 1954 dans la revue Critique, lui reproche de « substituer à l’histoire réelle une histoire à chaque instant ironique ou tragique », ce qui n’empêche pas d’importantes convergences entre les deux auteurs, comme en témoigne Démocratie et totalitarisme de R. Aron, paru chez Gallimard en 1965 .
Il va donc falloir, puisque la petite histoire cristallise dans la grande, que Arendt revienne sur le fait culturel et politique lourd de sens depuis 1945 : Etre juive.
« Le mot « juif » n’a jamais été prononcé entre nous à l’époque où j’étais une petite fille », rappelle Arendt dans une interview .
Elevée par une mère « complètement irréligieuse », elle ne fut « éclairée » sur son « identité » de Juive que par les propos antisémites des enfants dans la rue, la recommandation maternelle étant dans ces cas-là de ne pas baisser la tête, mais de se défendre.
Martha, la mère de Hannah, prenait plus au sérieux les propos antisémites des professeurs de lycée : « J’avais reçu pour consigne de me lever aussitôt, de quitter la classe et de rentrer à la maison faire un compte rendu exact de ce qui venait de se passer . »
Sa mère écrivait alors une de ses nombreuses lettres recommandées de protestation, et Hannah bénéficiait d’un jour de congé.
Il y a là, encore, un mécanisme qui consiste à nier, à sacrifier la connaissance et la reconnaissance d’une culture, d’une éducation, afin de partir d’un fait qui donne une identité politique que dans la grande histoire : « je suis juive . »
On pourrait penser que s’affirme, dans ses aveux d’Arendt, une définition laïque, non religieuse, de l’identité juive. Cela se révèle insuffisant.
Elle écrit : « Je ne me définis pas comme quelqu’un qui partage une religion, mais j’assume mon identité en me défendant toute seule, et j’écris - nous écrivons - à qui de droit, car je crois - nous croyons - qu’il est possible de juger les injustices. »
L’universalité de l’homme s’articulera en évitant deux écueils :
1. Eviter une prétendue neutralité qui ne serait qu’une fébrilité, ou un aveuglement.
2. Refuser la position d’un spectateur docile, soumis. Il s’agit, pour la philosophe de penser et de se vouloir critique.
Dans un échange désormais célèbre avec Scholem après le scandale provoqué par son compte rendu du procès d’Eichmann sur lequel nous allons revenir, Arendt récuse une certaine vision de la religion dont se servaient certains dans le but plus ou moins avoué de transférer en réalité l’esprit religieux au culte de l’Etat, ou du peuple providentiel : le « peuple » juif. En gros, et pour le dire vite, sans Dieu, le peuple est notre Dieu.
A l’encontre de cette attitude, elle affirme une position originale lui permettant de ne pas enferrer le politique dans le communautarisme : rejetant le nihilisme, il lui importe de repenser la tradition (« croire en Dieu ») par une interrogation continue de la transcendance.
Telle est, selon Arendt, la condition indispensable pour que chaque individu soit respecté et puisse renaître à l’intérieur d’une communauté politique plurielle.
La Philosophe écrit : « Permettez-moi de vous raconter la conversation que j’ai eue avec une personnalité politique de premier plan. [Il s’agit de Golda Meir dont elle fait disparaître le nom pour la publication] qui défendait l’absence de séparation, désastreuse à mes yeux, de la religion et de l’Etat en Israël. [...] Vous comprenez qu’en ce qui me concerne, en tant que socialiste, je ne crois évidemment pas en Dieu, je crois dans le peuple juif. J’ai trouvé cette déclaration [La déclaration de Golda Meir] scandaleuse [...]. La grandeur de ce peuple [Le peuple juif] est venue un jour de ce qu’il a cru en Dieu, et qu’il a cru en lui de telle manière que sa confiance et son amour étaient plus grands que la crainte. Et voici qu’à présent ce peuple ne croirait plus qu’en lui-même ? Quel bien peut-il en advenir ? »
Il appartiendrait donc à l’homme de penser sa propre universalité, depuis la place qui est la sienne ? Toute construction d’un homme universel ne pourrait que refuser la « divinisation » de l’homme ?
Tout en considérant que nous naissons à chaque acte de notre pensée, Arendt se vit empreinte de l’éducation parentale et de la langue maternelle . Il ne s’agit pas, en tout cas, pour la philosophe, de perdre les racines de sa propre identité : Ce qui définit notre présence dans le rapport à l’autre.
A cela s’ajoute sa conviction que la judéité est une « donnée », un « air », écrit-elle : ce qui la fait apparaître telle dans l’espace, toujours politique, des autres.