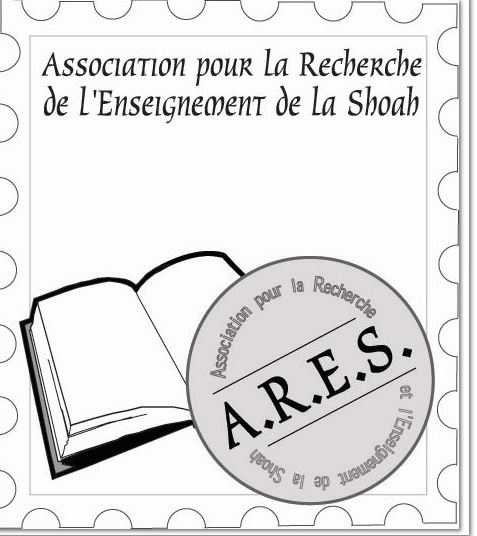Temoignages recueillis par Suzette Hazzan suite 1
par
Henri ISRAËL
(13 ans en 1943)
Je suis marseillais et je suis né dans cette ville en 1930. Mes parents étaient d’origine turque. Mon père Isaac Israël est né à Istanbul en 1888 et ma mère Suzanne Beni Fraïm à Brousse. Ils se sont mariés à Marseille le 3 avril 1913. Ils étaient commerçants. Mon père est mort alors que j’étais très jeune. J’ai vécu avec ma mère et son deuxième mari au 16, avenue du Prado à Castellane.
Mon frère Albert, qui venait d’être démobilisé en 1940, était revenu habiter avec nous jusqu’à son mariage célébré le 11 août 1942 avec Janine David dont le père Barouh David (né à Salonique) était un notable marseillais. Il possédait deux grandes bijouteries, sur le Quai du Port et sur La Canebière (la bijouterie Aristide Bel). Le jeune couple s’était installé rue Fondère. Les Allemands ont occupé Marseille à partir de novembre 1942 et nos inquiétudes ont commencé.
Jusqu’à cette époque, en effet, nous pensions qu’il ne pouvait rien nous arriver de grave. Je fréquentais l’école de la rue Saint-Sébastien et j’avais l’insouciance de mon âge. Ma mère est allée faire tamponner les cartes d’identité de la famille lorsque les autorités l’ont demandé. Elle a même pris celle de mon frère et celle de sa femme qui étaient absents et c’est moi qui leur ai rapportées lors de leur retour à Marseille. Je le regrette aujourd’hui. Mais nous ne savions pas l’importance de cet acte à l’époque.
Mon frère et sa femme sont revenus de voyage le 22 janvier 1943. Au lieu d’aller dormir chez eux, rue Fondère, ils sont allés chez les beaux-parents de David qui habitaient au 90, la Canebière (dans l’immeuble de la Librairie Tacussel). Il y avait là aussi deux sœurs de Janine, Liliane et Raymonde. Dans la nuit, a eu lieu la rafle de l’Opéra et du centre-ville. La police française est montée et n’a pris que mon frère, sa femme et son beau-père. Les autres sont restés. Malheureusement ils seront déportés plus tard. Au moment de leur arrestation, dans la nuit du 22 au 23 janvier, nous étions chez nous au Prado. Ma chambre donnait sur l’avenue et j’ai entendu passer de très nombreux camions durant toute la nuit. C’était des juifs raflés que l’on conduisait aux Baumettes. Ils ont été conduits à la Gare d’Arenc puis à Compiègne et à Drancy d’où ils partirent le 23 mars 1943 pour le camp de Sobibor où ils furent exterminés dès leur arrivée.
Par peur de nouvelles rafles qui se produiraient dans d’autres secteurs de la ville, ma mère a eu l’idée d’aller coucher le lendemain au 90, de la Canebière, là même où mon frère avait été arrêté. Elle pensait qu’ils ne reviendraient pas là. Nous y sommes restés un mois environ et sommes partis nous réfugier ensuite à Cannes pendant trois ou quatre mois. Nous nous y sentions plus en sécurité sous le contrôle italien. Puis, nous sommes partis en Savoie, à Brides-les-Bains, toujours sous le contrôle italien. Nous y sommes restés jusqu’à l’Armistice de Badoglio. À ce moment-là, nous nous sommes installés à Lamastre, en Ardèche, jusqu’à la fin de la guerre. J’y suis allé à l’école.
Nous avions des faux papiers et j’ai souvent changé de nom. La première fois, je me suis appelé Henri Isoard. Ma mère, étant remariée avec Monsieur Franco, nom qui ne faisait pas trop « Juif », je suis devenu aussi Henri Franco.
Les beaux-parents de mon frère étaient là aussi. Ils ont ensuite décidé de repartir et de louer une villa à Aubagne. Ils voulaient que nous partions tous. Ma mère a refusé. Ils ont été dénoncés et raflés à Aubagne. Sa belle-mère Paula et ses belles sœurs Liliane, Raymonde, Suzanne et son mari Saby Zaraya, avec leurs deux enfants, Henri, 5 ans et Claudie, 18 mois, ainsi que les deux parents de Saby Zaraya. Trois seulement sont revenus d’Auschwitz.
Les deux magasins de bonneterie, lingerie, confection que nous possédions à Marseille, au 17, et au 43, rue de Rome avaient été confisqués par le Commissariat aux questions juives et l’administrateur les avait vendus à des aryens.
À la Libération, ma mère et moi sommes revenus à Marseille en taxi. Très courageuse et audacieuse, accompagnée d’un huissier, elle a fait mettre dehors les occupants des deux magasins. Le propriétaire de celui de mon frère avait été mis en prison pour fait de collaboration.
Les Allemands étaient souvent venus nous chercher dans notre appartement du Prado, mais il y avait d’autres locataires. Ma mère l’avait prêté à un jeune couple qui ne savait pas trop où aller. À notre retour ils nous l’ont rendu. Ainsi nous avons récupéré une partie de nos biens, mais nous avions perdu nos proches.
Sur les actes de disparition que nous avons reçus après la guerre, mon frère et ma belle-sœur sont enregistrés comme ayant disparu à Maïdaneck alors qu’ils sont partis avec la plupart des juifs marseillais raflés en janvier 1943 dans le convoi n° 52 à destination de Sobibor.
Simone BERAHA
(14 ans en 1943)
Simone Beraha, 14 ans, raconte : « Lorsque mon père est rentré à la Maison, il nous a dit que le quartier du Vieux-Port était ceinturé par une multitude de soldats et policiers en armes. Il avait entendu dire, au cours de ses différentes conversations avec le personnel des services qu’il côtoyait journellement, que les quartiers du bas de la Canebière et du Vieux-Port allaient subir un nettoyage en règle pour les vider de tout ce qu’ils comptaient de mauvais sujets. Mon père, traducteur juré, avait ses entrées dans tous les commissariats, à la Préfecture, à l’Évêché, etc... Nous nous sommes endormis. C’était, je m’en souviens, le vendredi 22 janvier 1943. J’avais 14 ans et à cet âge, rien ne peut troubler l’esprit d’une adolescente.
Avant minuit, de grands coups sont frappés à la porte du 9 rue Vacon, près de la rue de Rome où nous logions. Ma mère alluma la lumière, ce fut une erreur. Les policiers montèrent frapper à la porte de notre palier. A l’ouverture de l’huis, mon père se trouva en face d’un inspecteur de Police qu’il connaissait très bien, de par sa profession. « Papiers, Moïse ! » le sens du devoir accompli !
Quelle ignominie que de demander l’identité à une personne que cet inspecteur connaissait... Il fallut obtempérer. Nous nous sommes habillés. J’ai pleuré en m’accrochant à ma mère. Ils eurent - ils étaient deux - un moment de pitié à mon égard, ils voulaient que je reste seule à la maison pendant qu’ils enlevaient mes parents. J’ai refusé, cela se comprend.
Les camions bâchés attendaient dans la rue. A l’intérieur, des connaissances. Il faisait froid, il faisait noir. Des gendarmes nous poussèrent sans aucune pitié dans le véhicule, nous entassant telles des bêtes. L’angoisse et le désarroi nous étreignaient. Qu’allait-il advenir de nous ? Ce fut la prison des Baumettes, hommes, femmes, enfants, en file indienne, dans une grande pièce glacée où des secrétaires prenaient nos identités sur des feuilles ou des registres. Cargaison humaine. Puis ce fut la séparation des hommes d’avec les femmes. Nous fûmes emmenées, nous les femmes et les enfants en bas âge, dans une autre prison attenante à la précédente. Les hommes n’étaient plus avec nous, nous ne devions plus les revoir, mon père et mon frère Joseph âgé de 16 ans. Toute la journée du samedi 23 janvier et la nuit du 23 au 24, nous les avons passées assises, couchées à même le sol d’un réfectoire avec, pour toute nourriture, un bol de soupe, sans plus. »
Jeanine SION née LAÏK
(10 ans en 1943)
Je suis née à Aïn-Kial près d’Oran le 25 janvier 1933. Mes parents étaient originaires d’Algérie. Mon père Chaloum avait un commerce au Maroc, mais il a fait de mauvaises affaires. Il est venu seul à Marseille pour chercher du travail. Son frère Simon était déjà installé à la Seyne-sur-Mer. Toute la famille est venue rejoindre mon père par la suite.
Ma mère, Rachel Karsenty avait toujours vécu dans son village d’Aïn-Kial. Ses parents tenaient une boucherie, élevaient des vaches et des chevaux et possédaient des exploitations agricoles, viticoles surtout. Mon grand-père et ses fils parcouraient les villages en calèches pour vendre la viande.
À notre arrivée à Marseille en 1936, nous avons d’abord vécu dans un hôtel meublé au 1, rue Nationale, puis nous nous sommes installés dans un appartement au 82, rue Longue des Capucins. Je suis restée là jusqu’à mon mariage, à 20 ans. J’allais à l’école communale, rue de l’Éclipse dans le premier arrondissement. Maman veillait toujours sur notre bonne tenue. Ainsi, lors de la visite du Maréchal Pétain dans notre école, la maîtresse nous a choisies, Gaby ma petite sœur et moi, pour lui remettre un bouquet et il nous a embrassées. Par respect pour la légalité, mes parents sont allés se faire recenser en tant que juifs. Nous voulions nous intégrer et ne fréquentions pas beaucoup la communauté et la synagogue. Malgré tout, mon frère allait aux Éclaireurs israélites. Nous vivions donc avec une certaine sérénité et mes parents ne s’inquiétaient pas trop. Une de mes camarades de classe dont le nom de famille était Paris me dit un jour : « À partir de demain je ne reviendrai plus en classe. Je quitte Marseille avec mes parents ». Cette amie était juive et je ne le savais pas. Elle a peut-être voulu m’avertir, mais j’étais jeune et je ne l’ai pas comprise. J’aurais dû en parler à mes parents.
Le soir du 23 janvier 1943, on frappe à notre porte. Il y a de grands bruits dans le quartier. Tout le monde se réveille et des policiers français, armés, dressent leur mitraillette devant nous qui dormions dans la pièce. Ils demandent les papiers à mon père. Maman prend mon frère dans ses bras. Les deux gardes mobiles demandent à mon père de les suivre. Mon père a dû comprendre. Il a parlé en arabe à ma mère et lui a remis sa carte d’alimentation. Il fut conduit aux Baumettes, puis à la gare d’Arenc où le train le conduisit avec les autres déportés du Vieux-Port à Compiègne puis à Drancy et de là au camp de Sobibor (convoi n° 52 du 23 mars 1943). Du train qui l’amenait à Sobibor, il a jeté une lettre qui nous est parvenue grâce à une personne qui l’a ramassée et envoyée. Il nous informait qu’il partait pour une destination inconnue. Il y avait avec lui un cousin Chouraqui et son fils de 20 ans. Le cousin propose à mon père de sauter tous les trois par la fenêtre. Le cousin a sauté et les autres non. Il a passé la nuit le long de la voie ferrée à les attendre en vain. Il est revenu à Marseille désespéré et n’a vécu que quelques années, anéanti par ce drame.
Maman a fait faire une fausse carte d’identité. Avec l’aide d’une cousine chrétienne de Paris, elle a obtenu un appartement à Saint-Honoré-les-Bains près de Nevers où la cousine possédait déjà une maison en location. Elle est restée avec nous et pour vivre, elle faisait du marché noir. Elle se rendait de temps en temps à Paris où elle possédait un magasin de lingerie fine, avenue Victor Hugo dans le XVIe et vendait des collants en soie et autres. Ma mère allait dans les fermes et proposait ses services. Elle faisait du pain, des gâteaux, des beignets en échange de nourriture. Nous étions ainsi mieux nourris. Pour ne pas nous faire remarquer, nous accompagnions tous les dimanches la cousine à la messe. Le curé voulait nous inscrire au catéchisme et notre refus l’intriguait. Nous prétextions que nous habitions trop loin du village. Et pourtant au mois de mai, lors de la fête de Marie, ce fut mon blondinet de petit frère qui a été choisi pour être le premier dans la procession, avec, derrière lui, la Sainte Vierge et la Croix.
Nous allions à l’école avec nos sabots et notre gamelle. Les cours avaient lieu dans le Casino qui ne fonctionnait plus. Nous y avons passé de très bons moments. On jouait au tennis ; c’était agréable. Il y avait d’autres familles juives. Certaines ont été dénoncées et ont disparu, mais pas nous. On ne fréquentait personne. Le maire lui-même fut très étonné de l’apprendre à la Libération, lorsque ma mère lui demanda de faire des recherches à propos de mon père, déporté racial. Elle s’est aussi rendue auprès du prêtre pour lui dire que les enfants n’iraient plus à la messe. Il l’a embrassée et félicitée d’avoir sauvé ses enfants.
Nous sommes restés à Saint-Honoré jusqu’à ce que le cousin qui avait pris notre appartement à Marseille s’en aille. À notre retour, maman a travaillé chez Bouchara comme femme d’entretien, puis rue de Rome chez « Dandy ». Elle cumulait divers travaux tels que la foire aux santons pour les fêtes de Noël afin de faire face aux nécessités de la vie quotidienne et de notre éducation.
Robert HASSON
(19 ans en 1943)
Je suis né à Cuba car mes parents s’y trouvaient de 1923 à 1925. C’est ce qui m’a sauvé la vie.
Mes parents sont d’origine turque tout comme les grands-parents paternels (Nissim Hasson, Rachel Hillel) et maternels (David Calma et Esther Lévy). Ils se sont mariés à Constantinople vers 1922 et ont quitté la Turquie en 1923 pour Cuba.
N’ayant aucune formation, papa faisait du colportage. La famille de maman avait également quitté la Turquie en 1923 pour Marseille. Ma tante a demandé à sa sœur de venir la rejoindre. C’est ainsi que mes parents se sont retrouvés à Marseille en 1925. J’avais alors un an. Mon frère David est né en 1926. Il était considéré comme français par le gouvernement de Vichy, au contraire de mes parents, qui n’ont même pas été reconnus comme turcs par le Consulat de Turquie et ont été considérés comme apatrides. Quant à moi, né à Cuba, j’étais cubain. Au moment des déportations, ces différences auront du poids. Nous avons été raflés dans la rafle de l’Opéra.
Samedi 23 janvier 1943 à une heure du matin, des coups violents sont frappés à notre porte d’entrée. « Ouvrez. Police ! » Mon père apeuré ouvre la porte : « Montrez-moi vos papiers », puis : « Combien êtes-vous dans l’appartement ? » Il y avait mon père Victor (46 ans), ma mère Donna (43 ans), mon frère David (17 ans) et moi (19 ans).
Mon frère et moi nous nous sommes levés. Maman étant malade est restée couchée. Nous avons pu voir deux gardes mobiles qui vérifiaient les papiers tendus par mon père. Ces papiers portaient en gros caractères rouges la mention : « Juif ». Mon père ayant respecté les instructions de la police vichyssoise, pensait que l’interrogatoire en resterait là. « Habillez-vous rapidement et suivez-nous jusqu’au commissariat pour le contrôle de vos identités » – « Ma femme est alitée, peut-elle rester couchée ? » – « Aucune importance, qu’elle vienne aussi, il n’y en aura pas pour longtemps ».
Nous nous habillons à la hâte. Personnellement, je pensais que ma composition de math pour le lendemain était bien compromise. Nous voici dans la rue. D’autres personnes, en rang, nous y attendaient. On nous demande de nous mettre à la queue. Quelques voisins se mettent aux fenêtres et assistent à notre départ pour le commissariat de la rue Tapis Vert, à une centaine de mètres de l’endroit où nous nous trouvions.
À l’entrée du commissariat, et sur deux rangées, une dizaine de gardes mobiles, fusil en bandoulière, nous firent signe d’avancer vers le fond de la salle. Là, je vis l’un de mes cousins (Fresco), bras levés, interrogé par un inspecteur très désagréable. À notre tour, nous avons décliné nos identités, montré nos cartes d’identités et cartes d’étudiants. On nous a demandé ensuite d’attendre au fond de la salle.
Peu de temps après, deux fourgons se sont arrêtés devant le commissariat. On nous y fit monter, puis nous nous dirigeâmes vers la prison des Baumettes.
Dimanche 24 janvier 1943 à 6 heures du matin, nous quittons la prison des Baumettes en cars de police.
Nous traversons Marseille à vive allure, par le Prado et la rue de Rome. Nous nous posons tous la même question : « Où nous emmène-t-on ? » Certains lancent par les fenêtres, sous le regard indulgent des deux gendarmes qui étaient chargés de nous escorter, des messages destinés à leur famille. Nous sommes finalement conduits à la gare d’Arenc. Les cars pénètrent sur le quai. Un groupe de soldats allemands et de gendarmes français nous y attend.
À notre descente, les soldats arment leur fusil-mitrailleur. À l’aide de chiens policiers on nous fit monter dans des wagons à bestiaux qui se trouvaient devant nous. Nous étions serrés les uns contre les autres. « Schnell ! Schnell ! » Je dois avouer, qu’à ce moment-là, je me suis rendu compte de la gravité de la situation. J’ai pu monter dans le même wagon que mon père. Mon frère était dans un autre. Quant à maman, que je n’avais pas revue, elle devait certainement se trouver dans le wagon réservé aux femmes.
Notre wagon fut rapidement plein. La grande porte se referma dans un bruit sourd et nous nous sommes trouvés dans le noir. Au début il y a eu quelques plaintes, mais la grande majorité était silencieuse, comme moi et mon pauvre père. Nous étions prostrés.
Nous avons attendu ainsi toute la journée du 24 janvier. En milieu de journée, la fatigue (nous étions toujours debout), la chaleur et surtout la soif avaient considérablement changé l’atmosphère. Certains prisonniers, tapant contre les parois, réclamaient à boire. La pagaille était à son comble, lorsque la porte s’est entrouverte et que l’on nous eu jeté quelques miches de pain. Ce fut la ruée vers ce pain.
N’en pouvant plus, je me suis surpris à crier : « Arrêtez-vous bande de sauvages. Vous vous conduisez comme des bêtes… ! » À mon grand étonnement, tout le wagon s’est calmé, attendant la suite. Le scoutisme m’a beaucoup servi à ce moment-là. Je continuais sur le même ton : « Nous allons nous diviser en équipes. Alignez-vous de façon que je puisse voir les rangées ». Ce qui fut fait dans un ordre très relatif. Je vérifiais le nombre d’hommes par rangées. Le calme était revenu.
Je demandais au premier homme de chaque file de venir près de moi, autour des miches de pain. Par chance, quelqu’un avait sur lui un petit couteau. Difficilement et avec beaucoup de patience, j’ai pu partager les miches en parties à peu près égales. Je demandais à chaque chef de file de bien vouloir distribuer ce pain à chaque homme de son équipe. Le calme était définitivement revenu car nous étions à jeun depuis six heures du matin. Peu de temps après, le train s’est mis en marche très lentement, ce qui, malgré tout, nous a permis d’avoir un peu de fraîcheur. La question qu’il fallait ensuite résoudre était celle des WC. Un angle du wagon a été réservé pour cet usage. La question d’eau s’est ensuite posée. Malgré le froid, nous avions énormément soif. Heureusement le train s’est arrêté à une gare, nous avons pu avoir un grand seau d’eau, porté par deux Français en civil, accompagnés de deux soldats allemands. Il nous a été impossible de savoir où nous étions. Les Français avaient reçu des ordres précis.
Nous avions laissé s’asseoir les plus âgés, les autres restant toujours debout. On me demanda, une nouvelle fois, de trouver une solution. Il me revint l’idée de reformer mes files d’hommes. De faire asseoir le dernier de la file, jambes écartées, puis le suivant de la même manière, jusqu’au premier. J’ai pu obtenir ainsi que tout le monde soit assis bien qu’un peu serré. La fatigue aidant nous avons pu ainsi sommeiller.
Durant la nuit, quatre détenus sont devenus fous et poussèrent des cris stridents. Nous avons ainsi voyagé jusqu’au lundi 25 janvier. Le train s’arrêta à une gare. On nous fit sortir. Nous étions arrivés à Compiègne et on nous amena au camp français de Royallieu.
Toute ma famille a été déportée. Je suis le seul rescapé. Mon père, ma mère et mon frère sont morts à Sobibor et à Auschwitz.