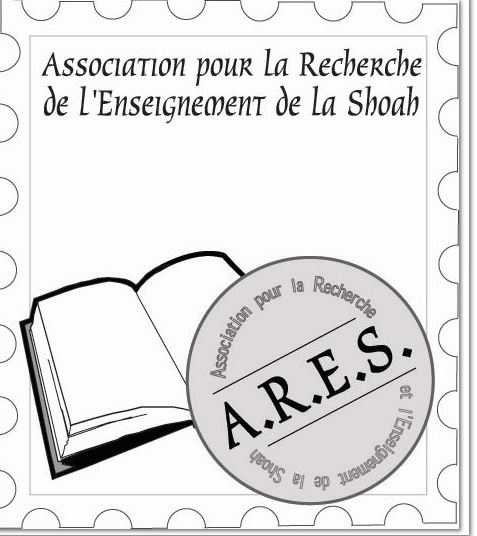temoignages recueillis par Suzette Hazzan
Sarah LEVY
(13 ans en 1943)
Je suis née le 8 septembre 1930 à Lyon de parents turcs. Mon père, Haïm, était originaire de Constantinople et y exerçait le métier de cordonnier. Ma mère, Myriam, était de Smyrne où la famille s’était installée après l’expulsion d’Espagne.
J’avais dix mois lorsque nous sommes arrivés à Marseille. Nous avons habité tout d’abord dans le quartier de l’Opéra, 18, rue Beauvau puis au 4, rue du Lacydon, derrière la mairie. Mon père est venu s’installer là parce que son frère aîné était à Marseille depuis longtemps.
C’est ainsi qu’il a rencontré ma mère par hasard. Elle était venue de Smyrne à Marseille pour faire la connaissance d’un jeune homme qu’un membre de sa famille lui avait proposé comme fiancé. Mais elle ne l’a pas voulu. Elle a rencontré mon père à ce moment-là et ils se sont mariés en 1926.
Mon papa a d’abord travaillé avec son frère dans son entreprise de cuirs et de peaux située boulevard de Paris. Il est devenu ensuite docker.
Mes parents fréquentaient la synagogue, rue Breteuil. Mon père fabriquait les galettes pour les fêtes de Pessah. J’avais commencé à apprendre l’hébreu et mon frère aîné a fait sa Bar-mitzvah. Presque tous nos voisins étaient juifs originaires de Grèce ou de Turquie. Mon frère Albert, malade du poumon, avait, grâce à l’OSE, pu entrer au sanatorium, ce qui lui a sauvé la vie, car il était hors de Marseille pendant les rafles.
Dans la nuit du 23 au 24 janvier 1943, la police criait dans tout notre immeuble, passait partout, frappait aux portes des appartements. Mon père a ouvert et le policier français dit : « Habillez-vous, on vous amène pour des renseignements. Ce ne sont que des formalités ».
Toute la famille était là, sauf Albert. Mon père a poussé mon frère Léon dans les escaliers pour qu’il se sauve, il passerait inaperçu tellement la panique était grande. Mais Léon est remonté et s’est caché sous un lit. Mon plus jeune frère, Isaac, est resté agrippé à ma mère. Les policiers ont seulement fait descendre mon père. Il partira avec les autres juifs arrêtés, à Compiègne puis à Drancy et sera déporté à Auschwitz par le convoi n° 59 du 2 septembre 1943. Nous avons reçu plus tard un mot envoyé de Compiègne nous disant qu’on les envoyait à Drancy, et un autre dans lequel il écrit : « Je pars, destination inconnue ». Puis, plus rien.
Nous sommes restés à la maison jusqu’au lendemain matin, dimanche 25 janvier, où il a fallu quitter ce quartier du port qui devait être complètement évacué et détruit ensuite. Des camions nous ont conduits avec les autres habitants, juifs rescapés de la rafle de la veille et non juifs, à la gare d’Arenc et nous nous sommes retrouvés dans un camp militaire à Fréjus. Nous y sommes restés environ dix jours. Nous dormions sur de la paille, les familles côte à côte sans aucune intimité. Puis, nous sommes revenus à Marseille.
Notre maison avait été rasée. Nous ne possédions plus rien, seulement ce que nous avions sur nous. On nous a placés dans un foyer de la mairie, rue Puvis de Chavannes. Deux ou trois jours après, la sœur de ma mère nous a invités à venir habiter chez elle, à Lyon, rue Montesquieu. Puis nous avons emménagé dans un appartement. La Gestapo nous recherchait. Il fallait souvent se cacher pendant de longues heures. Des religieuses nous ont procuré des faux papiers. Nous étions devenus la famille Loiseau, et moi, Denise Loiseau. J’ai été ensuite placée dans une famille, dans un village proche de Lyon. J’y ai passé mon certificat d’études. Mon frère Isaac avait été envoyé dans une ferme. Notre mère faisait le ménage chez les sœurs. On l’appelait Marie. Nous sommes restés là jusqu’à la fin de la guerre. Alors je suis retournée à Marseille. J’ai trouvé du travail comme apprentie modiste et je me suis mariée en 1948. Ma mère et mes frères sont partis s’installer en Israël en 1948.
Victor ALGAZI
(13 ans en janvier 1943)
Le cartier de l’Opéra était très convivial. Il y avait des Italiens, des Maltais, des Grecs, des Marseillais, des Arméniens. On n’a jamais connu de racisme. Quand j’allais faire mes devoirs chez mes copains, leurs mères partageaient le goûter de leurs petits…
Je suis né au 11, rue Saint-Saëns ; il y avait un coiffeur italien, Di Muro, dont les chants ont bercé mon enfance... « Nassi », le restaurant de grande classe où l’on soupait après l’opéra... Madame Arnaud, la pharmacienne, qui a été une grande résistante. Plus loin, le bar Cohen dont le père et le fils ont été raflés ; on dit que le père a eu les jambes section¬nées en voulant s’échapper du train... Dans les rues Corneille et Molière, il y avait des familles d’Afrique du Nord, les Chouraqui, les Benhaïm, les Habboute, des gens très durs au travail ; ils ont été les premiers à lancer la cuisine : les mer¬guez, le couscous... on allait chercher un plat... Mon père Joseph vendait les pis¬taches, les produits d’Orient, il était connu de tout le quartier avec sa blouse grise et son mouchoir de Cholet autour du cou, installé au n° 20 de la rue Saint-Saëns. Rue Glandevés ; Mavromatis le bottier, Kaimakis le coiffeur et Bazile Chrissfidis représentant la colonie grecque, sans oublier, bien sûr, tous les Corses, qui nous ont protégés et récon-fortés dans ces durs moments et chaque fois que nous avons eu besoin d’eux... Quand, de Turquie on partait pour Marseille, on disait : « Tu vas à la place de l’Opéra, tu vas manger chez Lévi », c’était de la bonne cuisine turque et grecque. C’est lui le père Bension Lévi qui le premier a fait le couscous à emporter. C’était le rendez-vous de la communauté. Le soir, ces hommes d’Orient allaient chez Cohen boire l’anisette qui coulait à flots et déguster le mezzé et après, nos mères nous envoyaient récupérer nos pères. Oui, donc je disais, toutes ces familles qui arrivaient, en débarquant, allaient d’abord voir mon père, puis pour avoir des cartes de séjour, elles allaient voir Moïse Beraha. On le surnommait « Moïsico el Bachico ». Il était traducteur juré, il avait son bureau à la rue Vacon, mais la plupart le retrouvaient au bar Léon (à l’Opéra), où il tenait des permanences. Puis il accompagnait tous ces émigrés au Bd de Louvain, au commissa¬riat des étrangers. C’était un saint homme, une figure marseillaise ! Il a fait les papiers de la plupart des familles judéo-espagnoles de Marseille et de la région, d’Aubagne, de Gardanne... Puis il y avait le père d’Aline de la rue Chevalier Roze, Maurice Horras. Il a été un des fondateurs des premières sociétés de bienfaisance et de la première communauté à Marseille de rite judéo-espagnol : « Bné-mizrah ».
Nous, les minots de la place de l’Opéra, notre travail c’était de garder les places au poulailler. On ouvrait les portes des taxis. Après, embauchés par M. Albert, on faisait les figurants et on chantait dans Carmen : « Nous marchons la tête haute comme de petits soldats... »
Et voilà comment nous nous sommes intégrés très vite, des Français à part entière, la majorité des habitants étaient des Judéo-Espagnols ; c’était la deuxième vague après celle d’Afrique du Nord, venue après 1920, après le démembrement de l’Empire ottoman. Ma mère est venue de Smyrne après les affrontements entre les Grecs et Mustapha Kemal. Elle est partie pour se marier en Argentine. Elle avait 23 ans, le « Pierre Loti » a fait une escale à Marseille, elle y est restée...
La guerre
Nous avons commencé à avoir peur lorsqu’il a fallu faire tamponner nos cartes d’identité et d’alimentation. Jusque-là, nous avions confiance. Je me souviens, nous étions allés avec toute la classe applaudir le Maréchal Pétain sur le quai des Belges, les gens lui faisaient confiance, c’était le vainqueur de Verdun, le sauveur de la France...
Le 22 janvier 1943
Je sortais de l’école, je venais de la rue de la Paix, je passe par la rue Sainte, je tourne à la rue de la Darse (actuellement rue Davso) et je vois des cordons de GMR, il y avait un camion, on sentait qu’il se préparait quelque chose d’anormal, ça sentait la poudre, mais on ne savait pas ce que c’était ; ils avaient mis les fusils en chien de fusil, il y avait des troupes habillées en bleu, des camions bâchés. Les gens s’évanouissaient dans la nature. C’est dans la nuit que cela a commencé. On entendait des bruits de pas, de chaussures cloutées. Quand on a frappé à notre porte, on a entendu : « Ouvrez ! », ma mère s’est levée, elle a ouvert : « Qui il y a dans cette maison ? Combien vous êtes ? Vos papiers ! »… « Où est votre mari ? » - « Je n’ai pas de mari, je suis veuve ». Il prend les papiers de ma mère, regarde derrière lui, met son pied en travers de la porte, « Vous vous appelez Léon, Luna, vous êtes née en Asie Mineure, à Smyrne ? » Je le revois, j’étais devant la porte, il l’a refermée, ma mère tremblait comme une feuille. « Je vais vous dire quelque chose, j’ai fait mon service militaire à Smyrne, là-bas c’est un beau pays, j’ai vu des gens très bien. Vous allez me faire plaisir, fermez cette porte, éteignez la lumière et ne répondez à personne pendant 24 heures ». Ma mère a fermé la porte, éteint la lumière. Soudain, on a tapé et on a entendu la même voix : « C’est fait, ils sont descendus ». On entendait descendre, cela devait être Arouto, M. Léon, M. Cohen, M. Mechulam. Ça montait, ça descendait. Quand enfin on est sorti, cela a été une consternation, la famille untel avait perdu tant, untel était parti avec le camion, qui avait perdu son mari et sa fille, qui avait perdu ses fils, l’autre son mari, ses enfants…
Roger Habboute, il habitait au 18, rue Corneille, c’était un super bon copain. C’est incroyable de penser à des jeunes de 14, 15 ans qu’un jour on ne revoit plus. Je pense à certaines familles comme Arrovas, à la Verdière, cette pauvre femme avait huit enfants, il en est resté deux, on l’a déportée avec ses enfants en bas âge. À la place de l’Opéra, il y avait la famille Bidjerano, on a déporté la petite de 4 ans, une de 7 ans et un fils de 14 ans. Le père et trois enfants. C’était selon l’humeur du flic, du GMR ; il embarquait le fils et pas le père, le père et pas le fils, ou les deux. Le quartier de l’Opéra était devenu malsain, tout le monde évitait le centre-ville parce qu’il y avait des rafles, des dénonciations.
Chacun a pensé à prendre ses valises et à partir, qui allait aux Camoins, à la Millière... Mais aller où, avec quels moyens ? Des amis arméniens nous ont dit : « Venez chez nous, nous les persécutions, on sait ce que c’est ! ».
On a même dû monter à pied à la Gavotte, on n’avait pas voulu prendre de moyen de transport parce qu’ils contrôlaient les papiers à des points straté¬giques. Ils relevaient les papiers aux lignes de bus, au terminus du 68. Il y avait souvent des rafles devant les cafés, les cinémas sur la Canebière, la rue de la République ; des Français de la Milice, en uniforme, qui travaillaient pour la Gestapo. On n’avait plus rien, plus de carte d’ali¬mentation parce qu’ils nous attendaient pour le renouvellement. Nous sommes restés à la Gavotte où j’ai vécu la fin de l’Occupation. Je n’ai jamais eu de faux papiers ; à la cathédrale, l’abbé Cas, un homme remarquable, un juste, qui a sauvé tant de vies m’avait proposé un acte de baptême et j’ai refusé parce que je voulais vivre la vie telle que je devais la vivre. Avec ma mère, on avait pris la décision de dire qu’on avait perdu nos cartes d’identité.
À la Gavotte, on dormait à six dans une pièce. Notre amie s’appelait Caroline Kaldiremdjian, que Dieu ait son âme, elle est morte à 103 ans, c’était une Ankarali, les Arméniens d’Ankara ne pouvaient parler l’arménien, sinon on leur coupait la langue. Alors, après deux ou trois générations, ils ne parlaient que le turc. Elle avait un cœur d’or. Je la revois se roulant des cigarettes la Caroline, j’allais ramasser des mégots pour elle. Elle se mettait sur le divan, elle était insomniaque et toute la nuit, elle chantait et moi je l’écoutais, elle chantait des chansons en turc, je ne dormais pas. Pour moi, c’était ma grand¬-mère, ce qu’elle a fait pour moi, je ne l’oublierai jamais. Elle me disait en turc : « ie, oloum, ie » (« Mange, mon fils, mange ») Manger quoi ? Je mangeais le morceau de pain dont elle se privait. Je n’avais pas de carte, elle allait mendier du blé, comme tous les Orientaux, avec le pilon elle en faisait une farine, elle enlevait le son. Elle arrivait à faire des genres de crêpes qu’elle passait au four pour pouvoir me nourrir.
Plus je pense à ça, plus je pense que j’ai eu de la chance, que je suis passé entre différentes mailles ; c’est qu’ils venaient à l’école, sur dénonciation… La famille Chouraqui, le fils Charles est resté seul, sans personne. Ils ont pris la mère à la rue Davso, elle a dit : « Je vais aller chercher mes deux filles à l’école », ils sont allés avec elle. La maîtresse a défendu les petites, mais ils les ont prises, à l’école de la rue Grignan. Charles Chouraqui fut recueilli par Mme Benhaïm au grand cœur. Je pense sans cesse à ces histoires, à celles de ma belle-famille. J’ai toujours en mémoire ce que m’ont dit les uns et les autres, en me promettant de transmettre tous ces témoignages…